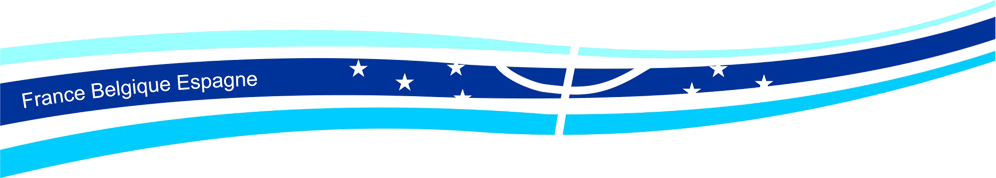IV- Marie de l’Incarnation au Canada
Accueil > Expositions > Marie de l’Incarnation > IV- Marie de l’Incarnation au Canada
Un esprit apostolique

Marie de l’Incarnation quitte la France le 4 mai 1639 pour le Canada avec deux compagnes, Sœur Marie de Saint-Joseph et Sœur Cécile de Sainte-Croix, ainsi que Madame de la Peltrie qui soutient financièrement leur installation. Sur le même navire, le St Joseph, se trouvent trois sœurs Hospitalières qui viennent fonder l’Hôtel-Dieu de Québec. Après un pénible voyage de trois mois, elles débarquent enfin à Québec, le 1er août 1639.

Elles vont d’abord loger dans une petite maison de la basse-ville pendant trois ans, le temps que se construise le monastère sur le Cap Diamant. Peu de temps après leur arrivée, elles commencent à accueillir des petites pensionnaires amérindiennes qu’elles vont nourrir, habiller, catéchiser, éduquer. Mais, très tôt, la petite vérole oblige les Ursulines à se faire infirmières pour soigner ces enfants. Marie de l’Incarnation, supérieure de la communauté, s’occupe également de la construction du monastère. Le 21 novembre 1642, la petite communauté s’y établit.
Marie de l’Incarnation s’active à plusieurs tâches : elle enseigne aux petites amérindiennes, tout en apprenant leur langue, elle fait la cuisine, car c’est ainsi qu’elle atteint les âmes. Elle prépare la fameuse sagamité : un mets très gras qu’ils aiment beaucoup. Il faut donc toujours en avoir un chaudron sur le feu.

Elle reçoit au parloir les parents de ses élèves ou encore les Jésuites missionnaires qui viennent lui raconter leurs expéditions. Elle est au courant de ce qui se passe dans la colonie, si bien qu’elle peut écrire beaucoup de détails à ses sœurs et ses amis de France. Sans compter qu’elle doit aussi commander les marchandises nécessaires à la vie d’ici et qu’on ne trouve pas au pays, faire venir même des ouvriers pour bâtir et rebâtir. Elle aime tellement ses chères petites amérindiennes qu’elle appelle « les délices de son cœur » ! Elle veut leur faire connaître Jésus et son message et continuer ainsi à bâtir une maison spirituelle à Jésus et à Marie, comme cela lui a été demandé.

 Le beau monastère de 1642 part en fumée le 30 décembre 1650, en pleine nuit. Les sœurs et les jeunes pensionnaires s’échappent en vitesse, pratiquement pieds nus dans la neige tandis que Marie de l’Incarnation qui a d’abord pensé d’aller chercher des réserves pour les sauver, se ravise et jette par la fenêtre les papiers importants du monastère avant de sortir à toute extrémité. Devant ce désastre, les sœurs chantent le Te Deum. Ceux qui les voient se disent : « Ou elles sont folles, ou elles sont saintes. »
Le beau monastère de 1642 part en fumée le 30 décembre 1650, en pleine nuit. Les sœurs et les jeunes pensionnaires s’échappent en vitesse, pratiquement pieds nus dans la neige tandis que Marie de l’Incarnation qui a d’abord pensé d’aller chercher des réserves pour les sauver, se ravise et jette par la fenêtre les papiers importants du monastère avant de sortir à toute extrémité. Devant ce désastre, les sœurs chantent le Te Deum. Ceux qui les voient se disent : « Ou elles sont folles, ou elles sont saintes. »
« On croyait que nous ne penserions qu’à notre retour en France après une telle perte qui nous jettoit dans l’impuissance de nous relever ; mais chacune de nous se sentoit si fortifiée dans sa vocation, avec un si grand concours de grâces, que pas une ne témoigna aucune inclination de retourner en son ancienne patrie. »
Elles se réfugient alors chez les Hospitalières pour un temps, avant de revenir habiter dans la maison de Madame de la Peltrie, tout près du monastère, entièrement détruit.
De concert avec le gouverneur et les responsables de la colonie, il est décidé qu’elles rebâtiront le monastère, malgré les dettes. Marie est alors chargée de faire les plans et de surveiller le chantier.
Le rôle et l’influence de Marie continuent ainsi à grandir : elle devient peu à peu une conseillère avisée que consultent le gouverneur, l’intendant et les administrateurs de la colonie.
Pendant les journées d’hiver, elle s’occupe à la broderie avec ses sœurs afin de confectionner des vêtements ou des parements pour la liturgie. Broderies magnifiques faites avec des fils d’or et d’argent qui ont été précieusement conservées et qui sont actuellement exposées au musée des Ursulines de Québec.
 Certains jours, il lui arrive aussi de composer pour ses sœurs :
Certains jours, il lui arrive aussi de composer pour ses sœurs :
« Je me suis résolue avant ma mort de laisser le plus d’écrits qu’il me sera possible. Depuis le commencement du Carême dernier jusqu’à l’Ascension, j’ay écrit un gros livre Algonquin de l’histoire sacrée et de choses saintes, avec un Dictionaire et un Catéchisme Hiroquois, qui est un trésor. »
Si l’on en juge par ses écrits, on constate que Marie de l’Incarnation était infatigable.
Mère spirituelle de l’Église canadienne, elle ressent le contrecoup de toutes les épreuves infligées à son pays d’adoption.
Elle est une meneuse née, elle sait tenir ses positions et trouver habilement des consensus comme le démontre la controverse à propos du choix de la règle et du costume des sœurs. Dans les premières années, les sœurs provenant du monastère de Tours et de celui de Paris, les deux couvents ont des règlements et des costumes différents. Doit-on se conformer aux usages des Tourangelles ou des Parisiennes ? Malgré les pressions des Jésuites en faveur de Paris, Marie de l’Incarnation a sa propre vision des choses et réussit à rallier tout le monde derrière elle en rédigeant de nouvelles constitutions mieux adaptées à la réalité du pays tout en conservant les meilleurs éléments des constitutions de Tours et de Paris, et ce à la satisfaction de toutes.
Pendant 33 ans, elle assiste aux luttes acharnées des Français à s’implanter en Amérique du Nord. Depuis la toute petite bourgade qu’était Québec à son arrivée, en passant par les périodes plus inquiétantes lors des expéditions des Iroquois ou le martyre des Jésuites missionnaires, jusqu’à l’arrivée de Tracy et de l’intendant Talon qui vont apporter la paix et la prospérité au pays, Marie a vécu ces années dans son monastère, travaillant sans relâche, toujours bien informée de tout ce qui se passe au dehors, elle porte tout dans sa prière.


Peu à peu, les privations et les maladies mal soignées l’ont épuisée. Parfois ses lettres apportent un bulletin de santé peu rassurant : elle ne peut plus se tenir à genoux, sa vue baisse, toute nourriture a un goût amer. Et pourtant, elle se réjouit de penser que la fin approche, que bientôt elle pourra voir Dieu face à face.
Sur le point de mourir, elle envoie un message de tendresse à son fils : « Dites-lui que je l’emporte dans mon cœur » . Elle dit adieu à ses petites Amérindiennes et s’éteint le 30 avril 1672, à l’âge de 72 ans.
Crédits photographiques :
- - Arrivée au Canada : Archives du Pôle culturel des Ursulines de Québec.
- - Vue de Québec : illustration de Jean-Baptiste Franquelin (1688), Archives du Pôle culturel des Ursulines de Québec.
- - Marie de l’Incarnation à Québec (Basse-Ville) en 1639 : d’après une aquarelle de L.R. Batchelor, Archives du Canada, Ottawa.
- - L’incendie du premier monastère, 30 décembre 1650. Illustration par Lili Réthi tirée du livre de Mary Fabyan Windeatt Mère Marie of New France, publié en 1958 à New York.
- - Broderie : Archives du Pôle culturel des Ursulines de Québec.
- - Portrait de Marie de l’Incarnation : Archives du Pôle culturel des Ursulines de Québec.